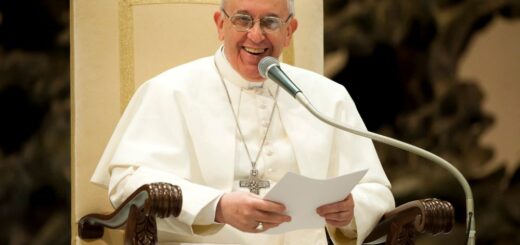Astéroïde 2024 YR4 : ses risques de collision avec la planète Terre ont doublé
Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’existence de l’astéroïde 2024 YR4 inquiète les astronautes. Vu sa trajectoire, l’Agence Spatiale Européenne (ESA) estime en effet que celui-ci pourrait entrer en collision avec la Terre le 22 décembre 2032. Mais cette météorite présente-t-elle réellement un risque pour notre planète ? Nous en parlons justement dans cet article. Découvrez dans ce qui suit ses caractéristiques, les probabilités d’une future collision avec la Terre, ainsi que les avis des scientifiques sur le sujet.
Ce que l’on sait aujourd’hui de l’astéroïde 2024 YR4
Bien plus qu’une scène de film de science-fiction, la présence inquiétante d’un astéroïde a été confirmée par la NASA et son homologue européen ESA. En effet, le 2024 YR4 a été repéré par l’observatoire de Rio Hurtado au Chili le 22 décembre 2024. Après son éjection de la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter, cette météorite semble se diriger dangereusement vers la Terre.
Mesurant entre 40 et 100 mètres de diamètre, son impact peut en outre causer des dégâts plus importants que la bombe atomique d’Hiroshima. Avec une masse avoisinant 220 000 tonnes, ce corps céleste pourrait en effet raser une grande agglomération. Depuis le 31 décembre 2024, il figure d’ailleurs dans la liste Sentry de la NASA qui regroupe les géocroiseurs passant à moins de 5 millions de km de la Terre et dont la probabilité de percuter notre planète est supérieure à zéro.
Quelles sont les chances que le 2024 YR4 entre en collision avec la Terre ?
Que des fragments d’astéroïdes tombent sur Terre est un phénomène fréquent. Néanmoins, il est rare qu’un rocher de la taille du 2024 YR4 se heurte à sa surface. Il y a quelques semaines, la NASA a en effet estimé à 1,2 % les risques qu’il entre en collision avec notre planète. Ce chiffre a cependant été réévalué à la hausse depuis. Selon des calculs plus récents, le risque est actuellement à 2,3 %.
Cependant, les scientifiques adoptent une attitude plutôt rassurante. Aujourd’hui, le 2024 YR4 est classé 3 sur 10 sur l’échelle de Turin, un algorithme qui évalue les risques de collision des corps célestes avec la Terre. Ce qui fait de lui un « objet à suivre ».
Malgré cela, cette évaluation est susceptible de changer avec le temps, et potentiellement de manière favorable. La NASA a d’ailleurs mis l’accent sur cela en déclarant : « Cette analyse initiale évoluera avec le temps, au fur et à mesure que de nouvelles observations seront recueillies ». Ainsi, les chances que cet astéroïde finisse sur Terre peuvent tout à fait tomber à zéro suite à de nouveaux calculs. En effet, c’est ce qui est arrivé à d’autres géocroiseurs considérés comme potentiellement dangereux par le passé. Cela a été le cas de l’astéroïde Toutatis (4179) qui a été considéré comme l’un des objets les plus menaçants pour la Terre avec ses 4,5 km de diamètre.
Les zones géographiques susceptibles d’être touchées par l’astéroïde
De l’avis des scientifiques, il est important de connaitre le point de chute du météore pour évaluer sa dangerosité. D’ailleurs, Andrew Rivkin, astronome planétaire, estime que dans la mesure où il frapperait la Terre, il est fort probable que « l’astéroïde se brise dans l’atmosphère » en plusieurs morceaux. Malgré cela, la zone d’impact éventuelle de l’astéroïde 2024 YR4 sur Terre reste vague jusqu’ici. En effet, les scientifiques et les astronautes estiment que celle-ci pourrait se trouver entre l’Est de l’océan Pacifique, le Nord de l’Amérique du Sud, l’océan Atlantique, l’Afrique équatoriale et l’Asie du Sud.
De surcroit, les probabilités qu’il tombe dans les zones océaniques ne sont pas à exclure. Si cela semble limiter les dégâts sur la terre ferme, les conséquences environnementales de l’impact seraient en revanche plus dévastatrices. Dans un tel cas de figure, sa chute pourrait provoquer des Tsunamis monstres et des tremblements de terre redoutables.
Agences spatiales et ONU : une action coordonnée face aux défis
Le seuil d’urgence défini par le Comité de pilotage du Réseau international d’alerte aux astéroïdes (IAWN ou Asteroid Warning Network) est de 1 %. Comme la probabilité d’impact est supérieure à ce chiffre, des procédures d’urgence ont été déclenchées. Pour la première fois depuis sa création en 2013, cette organisation est confrontée à une situation réelle de risque d’impact d’astéroïde. Cette expérience a d’ailleurs permis d’évaluer l’efficacité du réseau et de mettre en lumière les avancées significatives réalisées dans la gestion de ce type de menace.
Le Comité de pilotage a ainsi envoyé une notification au groupe des agences spatiales (SMPAG) pour coordonner une réponse internationale, incluant la planification de missions de déviation. Ce processus marque une étape cruciale dans l’histoire de l’IAWN et prouve que les systèmes mis en place, après des années de simulations, sont désormais opérationnels et capables de répondre à des situations réelles. Cette mobilisation a permis de vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble du dispositif tout en identifiant les zones nécessitant des améliorations pour mieux préparer l’humanité à faire face à ce genre de risque dans le futur.
Malgré la sonnette d’alarme, Kelly Fast, chargée des questions de défense planétaire à la NASA a déclaré que « personne ne devrait prendre peur à ce stade » en ajoutant qu’« il est encourageant de voir que la NASA et la communauté internationale gardent à l’œil » des menaces aussi lointaines et minimes.
En conclusion, bien que les risques liés à l’astéroïde 2024 YR4 aient doublé, il reste encore un certain temps avant que la menace soit imminente. En effet, l’astéroïde sera de nouveau visible en 2028, et ce sera à ce moment-là qu’il sera important de réévaluer avec précision les risques d’impact en tenant compte des observations récentes et des avancées technologiques. Les efforts coordonnés des agences spatiales et de l’ONU, ainsi que la mobilisation du Réseau international d’alerte aux astéroïdes, démontrent la vigilance collective qui s’exerce face à ce défi. Si les chances d’une collision restent faibles, la situation demeure sous étroite surveillance, et des mesures de prévention seront sans doute renforcées dans les années à venir.